Nous avons tenu bon !
Un an. Nous y croyons à peine… Un an que cette rubrique montée par jeu et par amour du jeu avec un curieux assemblage de personnalités, de médiums et de sensibilités, paraît rubis sur l’ongle tous les mois en miraculée du troisième jour. Malgré les catastrophes de dernière minute, les retards inévitables, les microbes les plus variés et les engueulades de rédaction, malgré les embouteillages de papiers à mettre en forme et en ligne sur le bureau de Vincent Cambier, notre rédacteur en chef et grand pourfendeur de l’erreur orthotypographique, malgré les disques durs fumant leurs derniers soupirs, les fatigues, pannes sèches et découragements chroniques…, nous avons tenu bon ! Et ce n’est pas sans fierté ni malice que nous pouvons dire : « Voici l’an » !
Alors, merci. Merci à ceux qui ont cru en nous dès le départ de cette drôle d’entreprise et qui n’ont pas hésité à donner de leur énergie et de leurs conseils. Merci à M. Cambier qui a su, en pétillant de la moustache, accepter d’accomplir ce travail de titan. Merci à nos lecteurs qui persistent à s’intéresser au beau et qui ont le courage de dédaigner la tentation ludique du résumé d’opinion en trois phrases. Merci, et mille fois, à cet équipage baroque qui n’a pas hésité à sauter à bord de cette embarcation aux voiles inassurées pour venir dessiner et questionner les mots du théâtre contemporain sur la simple foi d’un enthousiasme ! Merci enfin aux institutions, aux éditeurs qui nous relaient et travaillent avec nous en faisant ce pacte périlleux où la critique acerbe fait parfois partie de la donne.
Je n’oublie pas les auteurs, ces crieurs silencieux dont l’acharnement fait notre grain à moudre à tous dans le flux et le reflux de nos quotidiens. D’ailleurs, un anniversaire, c’est un moment à passer avec ceux qu’on aime, c’est pourquoi nous avons décidé de rencontrer deux de ces écrivains qui ont marqué ce tour du soleil en trente-cinq articles : Stanislas Cotton et Ahmed Madani. Deux très belles délicatesses avec lesquelles il fait bien bon avancer en âge.
Lise Facchin
« Le clown met tout à distance »
Il est toujours intimidant et risqué de rencontrer un artiste que l’on admire, dont l’œuvre nous émeut. Sera-t-il à la hauteur de son art ? Aussi généreux que ses textes ? Nous avons eu la chance de recevoir Stanislas Cotton un bel après-midi d’automne, autour d’une bouteille de Croze-Hermitage et de saucisses de Morteau. L’homme s’est révélé aussi beau que sa plume…

Entretien avec Stanislas Cotton » | © Frédéric Chaume
Dans l’œuvre de Stanislas Cotton, le thème qui nous a le plus frappés par sa récurrence est la figure du clown. Qu’elle apparaisse dans les titres, qu’elle en soit le personnage principal, ou que les situations burlesques dans lesquelles se retrouvent les personnages y renvoient, nous avons souvent pensé à l’univers du cirque ou de Jacques Tati en lisant Stanislas Cotton.
« Mon monde farfelu a des parentés, mais ce n’est ni voulu ni cherché » nous a-t-il répondu. La Gêne du clown (1), par exemple, est une mention fortuite. Alors qu’il était à une rencontre avec des élèves de l’Est parisien, un adolescent, profitant d’avoir un homme de lettres sous la main, lui demanda : « Mon père me dit tout le temps que j’ai la gêne du clown, vous savez ce que ça veut dire ? ». L’expression lui a plu et elle est devenue le titre d’une œuvre dont l’ouverture comique cache un sujet des plus sombres. En revanche, lorsqu’il se pose la question de la « porte dramatique » pour aborder le viol de guerre (2), Stanislas Cotton opte volontairement pour un clown, car « le clown met tout à distance ». C’est ici que se joue la démarche de l’auteur. En effet, il nous explique : « Le principe de mon travail est de m’éloigner du réel et de composer des personnages qui sont les plus improbables possible, par leur nom, leur façon de parler et la situation dans laquelle ils sont. J’essaye de mettre le lecteur ou le spectateur dans une situation où il se dit : “Ce que je vois là n’a rien à voir avec moi, je ne sais pas ce que c’est que ce truc”. Petit à petit, l’histoire se déroulant […], le spectateur se rend compte qu’en fait, c’est lui qui est sur scène. Que c’est de lui, du monde dans lequel il vit qu’on parle. Il y a fatalement un éloignement du réel. Ça n’a aucun sens d’écrire le réel sans le transformer. Il faut le faire exploser pour mieux en parler. »
Mais, pour autant, cela ne signifie pas que l’œuvre tombe dans la fantaisie la plus totale : « Le paradoxe, c’est que mes personnages ne sont pas vraiment réels, puisqu’ils sont bizarres… on ne sait pas trop où ils sont. Ils parlent, ils existent par leur parole, par ce qu’ils font, mais on pourrait les croiser en allant chercher du pain, parce que leur humanité les ramène à notre quotidien ». À ceci, l’auteur ajoute : « J’aime bien qu’on parle de gens normaux. Au théâtre, on parle souvent de personnages qui n’ont plus grand-chose à voir avec la réalité de la plupart des gens, beaucoup de traders… Mais je trouve plus intéressant de montrer les gens qui subissent les dommages collatéraux des désordres du monde, plutôt que les acteurs de ces derniers. C’est une autre manière de fonder la critique. ».
Une distanciation paradoxale indispensable selon Stanislas Cotton, qui écrit pour que « l’on s’en prenne plein la figure, pour qu’on ne soit pas épargné quand on voit la représentation d’un texte. Sans doute qu’aujourd’hui on n’a plus le droit à ça. L’émotion au théâtre, surtout pas ! Alors que moi, je rue dans les brancards dans l’autre sens, ça me semble nécessaire. Il faut mettre de l’humanité dans le théâtre, l’émotion qui va avec, de la sincérité. Des mots qui ne sont plus à la mode. On a besoin de retrouver des choses vraies au travers du média qu’est le théâtre, en tant que machine à rêves, machine à questions, machine à secouer. Interroger des questions de société d’aujourd’hui sous des formes particulières, c’est participer au monde d’aujourd’hui ».
« Ouvrir des petites portes »
Dans cette entreprise, l’objet livre tient une place particulière. Plus accessible et facile à faire voyager que les hommes et les mises en scène, les livres permettent aux auteurs de se rencontrer, de se lire, ainsi qu’un accès et une appropriation par tout type de public. Pour Stanislas Cotton, les opérations théâtre-éducation (3) de son éditeur Émile Lansman sont l’un des exemples de la force du texte édité : « Des centaines de livres arrivent dans les mains d’adolescents qui découvrent des textes écrits spécialement pour eux par des auteurs contemporains. Ils les montent dans des ateliers et ont la chance, après, de rencontrer les auteurs venus voir leur travail en cours, qui discutent avec eux et cherchent des solutions pour l’améliorer. C’est une très belle ouverture sur le monde pour des collégiens, des lycéens. Ils bénéficient de quelque chose de précieux : la gratuité de la parole, de la pensée, du partage de petites connaissances. ».
Stanislas Cotton se prête avec plaisir à ce type d’exercice : « Ça fait partie du travail d’auteur d’avoir cette proximité avec les plus jeunes à certains moments parce que si l’on peut, il faut ouvrir des petites portes dans les têtes. Se dire ensemble que le monde ne s’arrête pas là, que le monde est vaste. On a le droit de rêver, de penser et de créer. La vie ne s’arrête pas au cours de français, de mathématiques, à l’obligation de rendre ses devoirs. Non. Il y a au-delà tout un espace extraordinairement disponible, et chacun est à même de le conquérir ou de l’investir s’il dispose des outils pour y entrer. ».
Si le livre est le support de cet enrichissement mutuel entre l’auteur et son public, Stanislas Cotton y est encore attaché pour d’autres raisons : « Je suis encore de la vieille école : le livre est un objet que j’aime, j’ai une histoire plongée dans les livres (4) […]. Et tout bêtement, la publication, c’est aussi une reconnaissance. Je me rappelle très bien une époque où je revendiquais être un auteur, mais où je n’étais pas encore publié ni monté. J’étais totalement méprisé par certaines personnes puisque je n’avais aucun crédit. ».
Dans un contexte d’une scène belge francophone verrouillée au jeune théâtre, les débuts de la carrière d’auteur sont difficiles. Les jeunes générations s’organisent dans les années 1990 dans des mouvements de contestation, comme les états généraux du Jeune Théâtre (4), auxquels Stanislas Cotton participe. L’un des plus marquants pour lui fut RépliQ, collectif d’auteurs qui organisait des marathons d’écriture, des lectures, afin de donner une visibilité aux dramaturges francophones. « Ça a été une bonne école, on se retrouvait à quinze, vingt auteurs, on se lisait, on échangeait des commentaires, des critiques, on s’engueulait, on s’aimait… » Mais malgré l’enthousiasme foisonnant de cette scène, ses neuf premières années sont dures : « J’écrivais deux à trois pièces par an sans que jamais personne ne me dise quelque chose sur ce que je produisais – metteurs en scène, éditeurs, comédiens… Je n’ai jamais bénéficié d’un regard véritablement critique de la part de gens extérieurs au cercle des amis ». Un jour pourtant, une metteuse en scène l’appelle en disant : « J’ai vu cette pièce, je la monte » (6). « C’était assez surprenant. Et depuis […], ça n’a plus arrêté, ça a été toujours plus de travail. »
« Faire de la musique avec des mots »
Auteur prolifique, avec une trentaine d’œuvres publiées, et régulièrement montées (7), Stanislas Cotton, ancien comédien, reste néanmoins loin de la mise en scène. Et l’on se pose pourtant la question de la place de l’auteur et de la mise en scène, du devenir du texte de théâtre. Si un texte de théâtre est destiné à être dit, ses textes ont ceci de particulier de ne comporter aucune ponctuation, marqués par des rejets et des majuscules en milieu de ligne. « Je me suis inventé une graphie personnelle, qui est pleine de ponctuation. Pour moi, la ponctuation existe. Les gens me disent toujours : “Il n’y a pas de ponctuation, c’est bizarre”. Il y a une ponctuation. Très, très forte. Même plus imposée encore dans cette forme-là. Je crois que ce que j’essaie de faire avec cette langue, c’est d’entrer dans l’intimité des personnages et donc dans l’universel en touchant cette intimité. »
Car l’idée, c’est de tendre au rythme d’une parole du réel : « J’ai essayé de trouver la représentation qui était la plus proche de ce que je visualisais dans ma tête quand les idées surgissaient, ces phrases que l’on commence et qui ne se terminent pas. Et on en fait tous les jours ! Par ailleurs, le retour à la ligne et l’usage des majuscules sont des signes très clairs que l’on change d’idée et qui créent un rythme. Parfois, au-delà du sens qui se dégage des mots, c’est le rythme qui est le plus important. Si l’on prend Novarina, par exemple, ce n’est pas ce qui est dit qui est important, c’est la somme de tout ce qui est dit. Et le sens premier n’a plus beaucoup d’importance à ce moment-là. […] D’où la dimension poétique ».
Plusieurs comédiens lui ont fait les mêmes remarques sur le souffle porté par les choix typographiques du texte : « Un jour de répétition, un comédien est venu me voir et m’a dit : “Tu sais, c’est assez incroyable, je ne dois rien faire. Je suis le rythme du texte et je deviens dingue !”, et je trouvais que c’était assez sympa. Merci, l’auteur est content ! La musique, la rythmique est fondamentale. J’ai toujours rêvé d’être musicien et je n’y suis jamais arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Problème de gestion de rythme, de… je n’y suis jamais arrivé ! Je pense que j’essaie de faire de la musique avec des mots. ».
« Quand j’ai écrit un texte, il ne m’appartient plus »
Pour Stanislas Cotton, la surprise reste un élément fondamental du théâtre, ce qui explique en partie son rapport à la mise en scène. Nous lui avons fait remarquer que ses didascalies sont rares, et bien souvent au conditionnel. Assez caractéristique, cette didascalie du Roi bohème : « L’on pourrait entendre à des moments choisis l’Impromptu D 946 de Schubert. Peut-être le second mouvement à partir de ± 4’50” » (8). Un conditionnel qui laisse une grande liberté, tout en étant fort précis… « Les indications musicales sont tout à fait gratuites. Généralement, quand je rentre dans une écriture, il y a des musiques qui m’accompagnent, qui tournent parfois en boucle, parce que ça correspond à mon état ou à celui des personnages. […] C’est simplement une aide, un petit coup de main. Par exemple, le Roi bohème a été créé sans que la musique ne soit utilisée. C’est à la discrétion de chacun. Et puis, moi, j’aime bien être surpris aussi… Je fais des propositions, mais si on me propose autre chose et que ça me va… »
Le texte mis en scène est une aventure qui ne lui appartient pas : « Je suis l’opposé total de Beckett de ce point de vue. Lui exigeait que soit respecté à la respiration, à la virgule près tout ce qu’il avait indiqué. J’ai pour principe que quand un texte de théâtre est écrit, on le donne. Que ceux qui veulent s’en emparer s’en emparent et qu’ils en fassent du théâtre. Qu’ils essayent. S’ils réussissent, c’est très bien, s’ils se plantent, c’est tant pis. Quand j’ai fini un texte, il ne m’appartient plus, et c’est pour ça que j’écris beaucoup… ».
Être mis en scène, c’est éviter « les pléonasmes »
En sept ans, Vincent Goethals a monté cinq de ses pièces (9), et c’est avec plaisir qu’il collabore avec lui : « Il m’a surpris chaque fois. Je pense que tant qu’il me surprendra, je serai plutôt content de travailler avec lui. Et le jour où il ne me surprendra plus, ce sera mauvais signe… ».
Les deux hommes ont travaillé selon deux modalités. La plus fréquente est celle où le metteur en scène choisit un texte déjà écrit. Dans ce cas, l’auteur collabore de fort loin : « La première semaine de répétition, j’assiste au travail. C’est une semaine essentiellement destinée à se mettre d’accord sur le sens. C’est également une période pour favoriser la mise en bouche du texte par les comédiens […]. Puis, je m’en vais. Je n’ai alors pas le droit de voir quoi que ce soit avant la première ».
Dans le cas d’une commande, en revanche, le travail préparatoire est plus long : « Il y a des discussions pour savoir de quoi on va parler, selon quelles formes, des choses aussi simples que le nombre d’acteurs, etc. Là, c’est plus une collaboration. Pour le spectacle de l’été 2013 au Théâtre du Peuple de Bussang (10), le texte a été écrit petit bout par petit bout. Je lui en ai envoyé régulièrement. À un moment donné, il y a eu une matière, des espèces de moments de poésie, des petites histoires, des bulles de théâtre, des chansons, dont il a eu la liberté de construire l’ordre, en une espèce de cabaret […]. Puis, on s’est vu avec le musicien, les comédiens, pendant une dizaine de jours pour apprendre les chansons, se mettre d’accord sur les textes, et je suis parti. Et là encore, je n’ai pu entrer dans la salle qu’en même temps que le public le soir de la première. ».
À la question de savoir s’il a envisagé de se mettre en scène, Stanislas Cotton répond par la négative : « Un auteur qui se met en scène passe à côté de quelque chose, parce qu’il y aura fatalement un pléonasme. Je ne veux pas généraliser : il y a forcément des exceptions. Mais il est plus intéressant qu’un metteur en scène fasse son écriture sur un texte, qu’il y ait un peu de friction entre les deux, pour qu’il y ait des étincelles. Il est extrêmement important que les pratiques se croisent, que les différentes manières de faire du théâtre se croisent, puisqu’on se nourrit de ça. ».
Cette ouverture et cette curiosité au monde, au-delà de sa propre écriture, ont caractérisé les trois heures et demie d’interview que Stanislas Cotton a bien voulu nous accorder. Nous espérons avoir pu ouvrir nous-mêmes « une petite porte » sur son œuvre et que vous aurez autant de plaisir à lire ses pièces que nous en avons eu à l’entendre en parler… ¶
Cécile Cres / Frédéric Chaume
(1) Stanislas Cotton, la Gêne du clown, Lansman éditeur, Belgique, 2014, 54 p.
(2) Stanislas Cotton, Clod et son Auguste, publié avec le Roi bohème, Lansman éditeur, Belgique, 2013.
(3) Opérations mises en place au sein de l’association belge Promotion Théâtre www.promotion-theatre.org.
(4) Stanislas Cotton a été libraire, comme sa mère et sa sœur. Son père était critique littéraire.
(5) Mouvement qui regroupait des professionnels du théâtre « pour repenser le théâtre, le réinscrire dans le tissu social, sortir de l’individualité, discuter de leur profession en état de paupérisation grandissante, rassembler leurs énergies, confronter leurs expériences et préparer la rencontre entre jeunes compagnies, membres des pouvoirs publics, institutions théâtrales et de la presse », Prouvost C., « Les états généraux du Jeune Théâtre, la croisade continue », le Soir, 21 septembre 1994.
(6) Stanislas Cotton, Bureau national des allogènes, Lansman éditeur, Belgique, 2002. Créé en 2001 par Christine Delmotte.
(7) Outre les 26 pièces de théâtre, Stanislas Cotton a publié trois romans, une nouvelle et un carnet de voyage. L’intégralité de son œuvre publiée est listée sur son blog, qui recense également les mises en scène : http://stanislas-cotton.eu.
(8) Stanislas Cotton, le Roi bohème, Lansman éditeur, Belgique, 2013, p. 6.
(9) La liste des spectacles mis en scène par Vincent Goethals, directeur du Théâtre du Peuple de Bussang, est disponible ici : http://stanislas-cotton.eu/creations.
(10) Stanislas Cotton, Et si nos pas nous portent, Lansman éditeur, Belgique, 2013.
Critique la Princesse, l’Ailleurs et les Sioux :
Critique de Clod et son Auguste :
Sites de Stanislas Cotton :
http://stanislascotton.blogspot.fr/
Site de Lansman éditeur : www.lansman.org
« J’avais pissé du texte,
mais ça n’allait pas »
Ahmed Madani est auteur et metteur en scène, actuellement en tournée avec les deux premiers volets de sa trilogie « Face à leurs destins » explorant l’inconscient collectif franco-algérien. « Les Trois Coups » ont interrogé sur son parcours d’écriture cet artiste pour qui silence, souvenir et conflit des générations sont le terreau fertile sur lequel fleurissent ses pièces-enquêtes.

Entretien avec Ahmed Madani / Gabrielle Roque
Les Trois Coups. — Le titre de votre pièce « Je marche dans la nuit par un chemin mauvais » est un alexandrin de Lamartine : qui sont vos maîtres en écriture ?
Ahmed Madani. — Shakespeare pour sa dimension épique et poétique, Beckett pour sa construction dramaturgique et aussi pour ses thèmes. D’ailleurs, la première pièce que j’ai vue et qui m’est tombée dessus alors que j’étais encore ado, c’est En attendant Godot. Le metteur en scène était Pierre Orma, et c’est justement lui qui, vingt ans après, m’a raconté un jour sa guerre d’Algérie, ce qui est à l’origine de ma trilogie. J’ai noté tous ses souvenirs dans un petit carnet noir que j’ai enfoui dans mes tiroirs. Et puis d’un coup, dans les années 2010, alors que je faisais travailler des jeunes des quartiers populaires, je tournais dans ma tête un projet d’écriture sur les migrations, l’Algérie, la décolonisation et j’ai retrouvé le carnet. Tout s’est débloqué d’un coup.
Les Trois Coups. — Il y a une dimension de collecte de la mémoire dans vos pièces : comment avez-vous procédé pour récolter des témoignages ?
Ahmed Madani. — Il y a eu d’abord les souvenirs de Pierre Orma, bien sûr. Mais aussi, alors que je voulais rencontrer des anciens appelés d’Algérie, j’ai obtenu une résidence d’écriture à Argentan. On m’a très bien accueilli en me permettant de rencontrer beaucoup de retraités qui avaient vécu cette expérience. Dans la mesure où j’ai mené de front les deux projets d’écriture de Je marche dans la nuit et Illuminations, j’ai pu aussi collecter d’autres témoignages dans un second temps : par exemple les souvenirs du comédien Yves Graffey avec qui on travaillait sur Je marche dans la nuit. Un beau jour, alors qu’on partageait notre quotidien à la résidence d’écriture, il m’a sorti un carton de photos de sa guerre à lui. Ce qui était frappant, c’est qu’il n’y avait que des images montrant la joie de vivre. Cela en disait long sur le silence, le non-dit. Il a fallu faire travailler son inconscient. Il y a aussi un homme qui n’arrêtait pas de tourner autour de la résidence pendant qu’on y travaillait. Il a fini par m’avouer qu’il avait écrit plus de 500 lettres à sa femme pendant qu’il était soldat. Grâce à lui, j’ai compris qu’il fallait avoir une lecture subliminale de ces lettres, parce qu’elles étaient censurées puis finalement autocensurées par les soldats qui savaient ce qui passerait et ne passerait pas. Quand on a joué à Argentan, il m’a dit : « Il faut absolument que les jeunes voient ça ».
Les Trois Coups. — Visiblement, la résidence d’écriture a été un lieu important dans l’aboutissement de votre texte…
Ahmed Madani. — Oui, surtout la seconde résidence, qui a duré trois semaines en janvier 2012, avec les acteurs de Je marche dans la nuit. Quand je suis arrivé, j’avais mon intro et la scène centrale, j’avais pissé du texte, mais ça n’allait pas. Je leur ai demandé de me faire des impros et cela a déjà débloqué pas mal de choses. Mais surtout, j’ai été aidé par le fait de partager ma vie quotidienne avec Yves, qui est un homme âgé, choisi pour incarner le grand-père, et Vincent Dedienne qui est un jeune homme, interprétant le rôle de l’ado. Ils se sont mis à vivre devant moi. Ils n’ont pas la même façon de bouger, de s’habiller, de manger, de boire, ils n’écoutent pas les mêmes choses. Presque toutes les scènes « grand-père - petit-fils », je les ai écrites ou réécrites alors, la nuit, jusqu’à cinq heures du matin, en leur disant : « Ne faites pas de bruit ! », et le matin, des scènes nouvelles arrivaient.
Les Trois Coups. — En fin de compte, vous n’écrivez pas du tout dans l’ordre de la pièce…
Ahmed Madani. — Pas du tout. En revanche, il faut bien trouver un ordre à ces différentes scènes et pour cela, en tout cas dans Je marche dans la nuit, c’est la temporalité du repas qui m’a aidé. Avant le repas, on est plus dans le factuel, la préparation. Après le repas, c’est le temps de la parole libérée, plus paisible et plus profonde. J’ai souvent mis des scènes de cuisine dans mes pièces, avec des steaks, j’ai fait mastiquer les comédiens. L’ingestion, la mastication, la manducation sont non seulement un très bel exercice pour donner à la diction ce rapport de lutte de la parole avec la matière, mais en plus l’ingestion est une très belle image de ce qui n’arrive pas à passer, qui ne peut ressortir qu’au prix d’une joute pour savoir qui est le plus fort.
Les Trois Coups. — Dans Je marche dans la nuit, les monologues juxtaposés des deux personnages fonctionnent très bien. Avez-vous utilisé ce procédé uniquement dans cette pièce ?
Ahmed Madani. — Oui, car c’est une pièce au présent mais pas nécessairement contemporaine. Ce peut être un flash-back comme celui d’un fantôme qui se souvient de ce qu’il a vécu bien avant. C’est pratique pour construire une mise en abyme. Cela aussi, je l’ai trouvé pendant la résidence d’écriture à Argentan. Il n’y a pas les mêmes possibilités que dans un flash-back de cinéma, mais cela permet d’arrêter une scène à un moment qui deviendrait inintéressant. Les personnages peuvent prendre du recul par rapport à leur comportement, ce qui fait qu’ils ne se réconcilient pas sur scène mais dans l’après-coup.
Les Trois Coups. — Et les didascalies, qui sont assez abondantes, quel rôle leur donnez-vous, puisque vous êtes en même temps l’auteur et le metteur en scène ?
Ahmed Madani. — Les didascalies me servent d’abord à écrire, à créer l’espace et les idées d’action. Ensuite, elles ne me servent plus à rien ou alors elles sont très éloignées de ce qui se passe réellement. Par exemple, à un moment j’ai écrit « musique algérienne vive » : cela vous permet de savoir ce qui était dans ma tête au moment où j’ai écrit la scène, même si après ce n’est pas du tout ce fond musical qui a été choisi. Je suis très aidé par Christophe Séchet, qui compose mes bandes-son et qui m’a fait découvrir par exemple les musiciens minimalistes, Arvo Pärt ou John Cage. On a toujours une discussion commune sur le sens de la pièce, il me fait écouter des choses, on avance ensemble et on peut finir par mettre une musique de piano très neutre, marquant juste la temporalité, là où j’avais imaginé une « musique algérienne vive » !
Les Trois Coups. — D’une manière générale, vous réécrivez vos pièces au moment de la mise en scène ?
Ahmed Madani. — Oui, je gomme, parfois je change, mais surtout je supprime. Je ne note jamais la mise en scène, mais c’est parfois le texte que je refais entièrement. Par exemple, la scène du cauchemar, nous nous sommes aperçus en la mettant en scène qu’elle était beaucoup trop écrite. Et puis j’avais prévu des changements de costume, le personnage devait avoir au début un casque de soldat. Au moment de la mise en œuvre s’est posé le problème de ce que le comédien allait faire de son casque pour mimer un cauchemar. J’ai réécrit toute la scène avec le directeur du son. On est allé vers une simplification : le texte repris est inspiré de ce que j’avais écrit mais sous forme de bribes, dans un temps très court et en se recentrant sur une seule image, qui, d’un seul coup, m’est apparue comme simple et belle : celle d’un homme crucifié. Ce qui comptait finalement, ce n’était pas le cauchemar, c’était ce que le grand-père allait raconter après. Le cauchemar était réduit à un épiphénomène, à quelques voix contradictoires évoquant une culpabilité terrifiante. Quelques mots suffisent, la liberté des acteurs fait le reste.
Les Trois Coups. — Comment arrivez-vous à restituer si bien le langage des simples ?
Ahmed Madani. — J’écoute la sagesse de certaines paroles. Bien sûr, je n’emploie pas trop de mots, pas trop de langage soutenu mais pas toujours. Dans Illuminations, il y a un texte assez long où le mort parle, avec, à sa disposition, toute la puissance d’une langue riche. Mais sinon, je m’attache à la poésie de ceux qui en font sans le savoir. Je pense aux phrases de mon père qui était capable de me dire des choses comme : « Mon fils, il faut fréquenter la terre ». C’était un paysan, un homme de la terre devenu ouvrier chez Renault et envoyé en Indochine faire la guerre à d’autres paysans. J’avais sous-estimé son destin de déplacé, c’est-à-dire d’homme éloigné de la terre. Je suis sensible au langage des vieux paysans, dialogue très profond et qui passe par-dessus les mots. C’est d’ailleurs exactement le même problème que celui de l’ado qui ne peut pas parler de ses peines d’amour à ses parents. Cela aboutit d’ailleurs à une scène de crise : il faut attendre que le vieux soit en détresse parce qu’il comprend qu’on va le mettre dans une maison médicalisée, pour que les deux personnages s’embrouillent mais finalement se disent le plus important. ¶
Élisabeth Hennebert / Gabrielle Roque
Les deux premiers volets de « Face à leurs destins » sont les pièces :
Illuminations, d’Ahmed Madani
Création 2012
Programmation : Les Lilas, le 6 février 2015, puis Clermont-l’Hérault, Le Grand T de Nantes, Cholet, Carros, Briançon, Orly, Le Petit‑Quevilly, Argentan et Valenciennes
Je marche dans la nuit par un chemin mauvais, d’Ahmed Madani
Actes Sud, coll. « Papiers », 2013, I.S.B.N. 978-2-330-02691-2
56 pages, 12 €
Création : janvier 2014
Programmation : Digoin, le 14 février 2015, puis Maignelay-Montigny, Beauval, Ailly-sur-Noye, Amiens, Hirson…
Tous renseignements sur le site de Madani Compagnie : www.ahmedmadani.com

















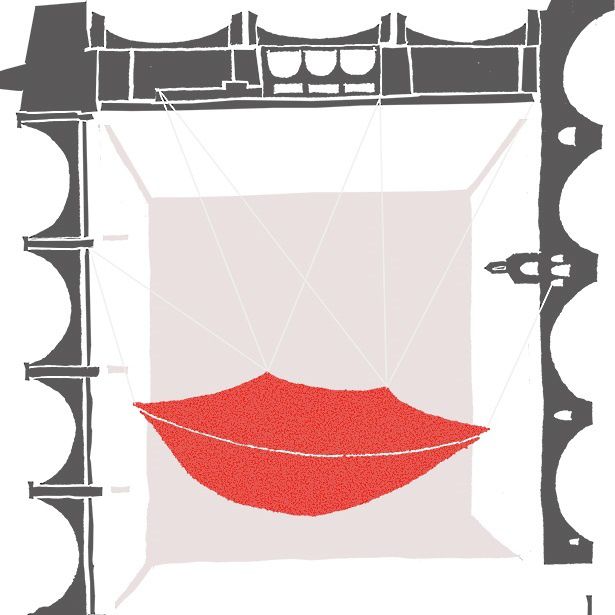









 Pour ceux qui s’en tiennent à quelques clichés sépia sur la Roumanie (en vrac : les Roms, les ouvriers du bâtiment, Ceaușescu et la Securitate) voici un diaporama mis à jour. En six saynètes abordant des sujets variés, cette pièce nous livre six instantanés cruels et réjouissants de la société roumaine. Les personnages de Solitarite sont élus locaux, jeunes cadres dynamiques, comédiens, prêtres, techniciens de théâtre, retraités, chômeurs, nounous philippines, chauffeurs de taxi. Ils ont des centres d’intérêts proches des nôtres. Même quand leurs débats font allusion de manière à peine masquée à l’actualité roumaine, ils nous renvoient à des questions brûlantes bien de chez nous. Ainsi la cathédrale du Salut-de-la-Nation-Roumaine en cours de construction à Bucarest est-elle aisément reconnaissable dans la « cathédrale de la Rédemption-Nationale » évoquée dans la pièce. Ceci nous renvoie au thème de la laïcité, des rapports entre Église et argent, et entre religion et modernité. De même, la scène ii qui s’inspire librement de la décision prise en 2011 par la municipalité de Baia Mare d’ériger un mur entre le quartier rom et le reste de la ville, nous renvoie aux options choisies par la France de Manuel Valls.
Pour ceux qui s’en tiennent à quelques clichés sépia sur la Roumanie (en vrac : les Roms, les ouvriers du bâtiment, Ceaușescu et la Securitate) voici un diaporama mis à jour. En six saynètes abordant des sujets variés, cette pièce nous livre six instantanés cruels et réjouissants de la société roumaine. Les personnages de Solitarite sont élus locaux, jeunes cadres dynamiques, comédiens, prêtres, techniciens de théâtre, retraités, chômeurs, nounous philippines, chauffeurs de taxi. Ils ont des centres d’intérêts proches des nôtres. Même quand leurs débats font allusion de manière à peine masquée à l’actualité roumaine, ils nous renvoient à des questions brûlantes bien de chez nous. Ainsi la cathédrale du Salut-de-la-Nation-Roumaine en cours de construction à Bucarest est-elle aisément reconnaissable dans la « cathédrale de la Rédemption-Nationale » évoquée dans la pièce. Ceci nous renvoie au thème de la laïcité, des rapports entre Église et argent, et entre religion et modernité. De même, la scène ii qui s’inspire librement de la décision prise en 2011 par la municipalité de Baia Mare d’ériger un mur entre le quartier rom et le reste de la ville, nous renvoie aux options choisies par la France de Manuel Valls. 


/http%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Flestroiscoups.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fbouh-1024_vincent-croguennec.jpg)







